Le mariage, de Dorothy West
Thom, ça ne lui suffit pas de faire jaillir quelques millions de caractères quotidiennement sur son golb. Il est pousse au crime, par dessus le marché. Il vous concocte des crossover en veux-tu en voilà pour vous impliquer dans la tourmente.
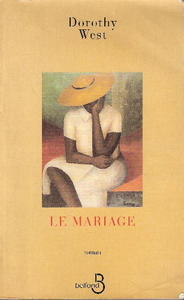 Et il a bien raison, car c’est une occasion de parler de ce qui habituellement n’aurait pas sa place sur ce blog. Comme ce magnifique deuxième roman de Dorothy West, Le mariage.
Et il a bien raison, car c’est une occasion de parler de ce qui habituellement n’aurait pas sa place sur ce blog. Comme ce magnifique deuxième roman de Dorothy West, Le mariage.Toutes les unions mixtes, toutes les accumulations de richesse n’y feront rien, c’est un monde gangréné par la méfiance envers l’autre et la crainte du mélange que nous décrit ce récit sans appel.

Distillant avec bonheur un contrepied après l’autre, Le mariage nous annonce dès le titre et les premières lignes un événement qui tarde à se concrétiser. La métis -et donc noire pour l’Amérique de l’époque- Shelby va épouser un blanc. Voilà qui ne convient à personne. Ni aux vieux noirs fiers d’avoir apporté la démonstration que leur race peut réussir par ses propres forces (et tous les métissages affaiblissent de fait cette démonstration). Ni à cette vieille société bourgeoise (peu importe pour le coup qu’elle soit noire) qu’on vient encombrer d’un saltinbanque, un musicien de jazz. Ni au voisin estival, ce vorace qui ne vit que pour ses filles et pour mettre les femmes dans son lit avant de les jeter. Ni aux parents du fiancé qui “perdent un fils”.
Ce n’est donc pas l’histoire d’un mariage. C’est l’histoire d’enjeux trop lourds et trop contradictoires pour permettre un événement de ce genre : un jazzman blanc désargenté épousant une héritière noire.
Le fauteur de trouble annoncé, on ne le verra pour ainsi dire pas, et c’est à peine si on en parle avant la 100e page. Tout se fait à la fois à cause de lui et à son insu, en son absence. Cette trouvaille narrative est lourde de symbole. Un jazzman blanc n’a pas sa place dans cette histoire, elle ne l’a jamais été.
A l’époque du groupe d’artistes Harlem Renaissance, dont faisait partie Dorothy West, les Blancs de New York venaient s’encanailler dans les clubs de jazz, précisément à Harlem. Des blancs buvant des coups en écoutant des Noirs. Mais le jazz était aussi en passe de devenir la grande musique populaire noire américaine, une musique qu’on danse avec ferveur (les jitterbugs) jusque dans les “rent parties”, ces soirées en appartement animées par des musiciens, où le prix d’entrée aidait à payer le loyer. A la fois grande musique et musique populaire, le jazz était la première musique à réussir pareil tour de force, et il le faisait par et pour des Noirs. Ce n’est pas rien, et se dire que des ouvriers noirs des années 50 puissent écouter Louis Armstrong comme leur collègues français écoutaient Ray Ventura, excusez du peu mais la comparaison n’est pas à notre avantage.

Ah, le jazz ! Aujourd’hui musique de blancs surdiplomés caressant leur barbichette dans des endroits hors de prix, elle était encore tout autre chose dans les années 1950. Le roman de Dorothy West se déroule en 1953. Avant le grand début de la lutte pour les droits civiques. Pendant les grandes heures du be-bop, Bird et Dizzy sont déjà au firmament, mais l’âge d’or reste encore à venir et on ne sait pas encore que des Blancs comme Bill Evans vont marquer cette musique. C’est encore Glenn Miller qui illustre le jazz de Blancs, un jazz d’apparat, en grandes pompes et débarrassé de son naturel et sa fureur (ou Dave Brubeck version jazz savant). En France, un trompettiste médiocre, Boris Vian, contribue pour sa part à un jazz des caves, un jazz des jeunes.
C’est ce fossé générationnel que vit Meade, le pianiste fiancé à Shelby Coles, en butte aux préjugés. Comme si, retournement ironique de l’histoire, dans ce roman les Noirs ne voulaient que prendre des Blancs (leurs usages bourgeois, leur richesse) mais pas leur donner (en l’occurrence leur musique). Dorothy West pousse loin le portrait cruel de cette communauté de nouveaux riches noirs, qui se caressent la vanité dans leur quartier refermé mais refusent de voir qu’ils ne vivront jamais dans le même monde que les Blancs.
La musique n’intéresse pas beaucoup Dorothy West, même si le choix du personnage de Meade ne doit rien au hasard ou à la fantaisie. C’est le paradoxe de ce livre, dont les va-et-vient temporels assurent un rythme de ritournelle, et dont les constants jeux de miroir peuvent évoquer des motifs et leur variation repris par la voix et différents instruments, comme autant de chorus et repons.
La subtilité de l’écriture, mais qui évoque à chaque page le sexe et la violence, n’est pas non plus dépourvue de lien avec le jazz, musique élaborée et complexe en même temps que sexuelle et spontanée.
Comme si le jazz était la métaphore invisible de ce roman, l’image subliminale de l’impossible histoire des Noirs d’Amérique, saisie à l’aube d’une période clef. Reste à savoir quand il a été écrit. Car ce livre est une aberration. Dorothy West ne l’a publié qu’en 1995, à l’âge de 88 ans!
Le Mariage est réédité en poche au Serpent à plumes. Vous savez quoi lire.
Tweet
